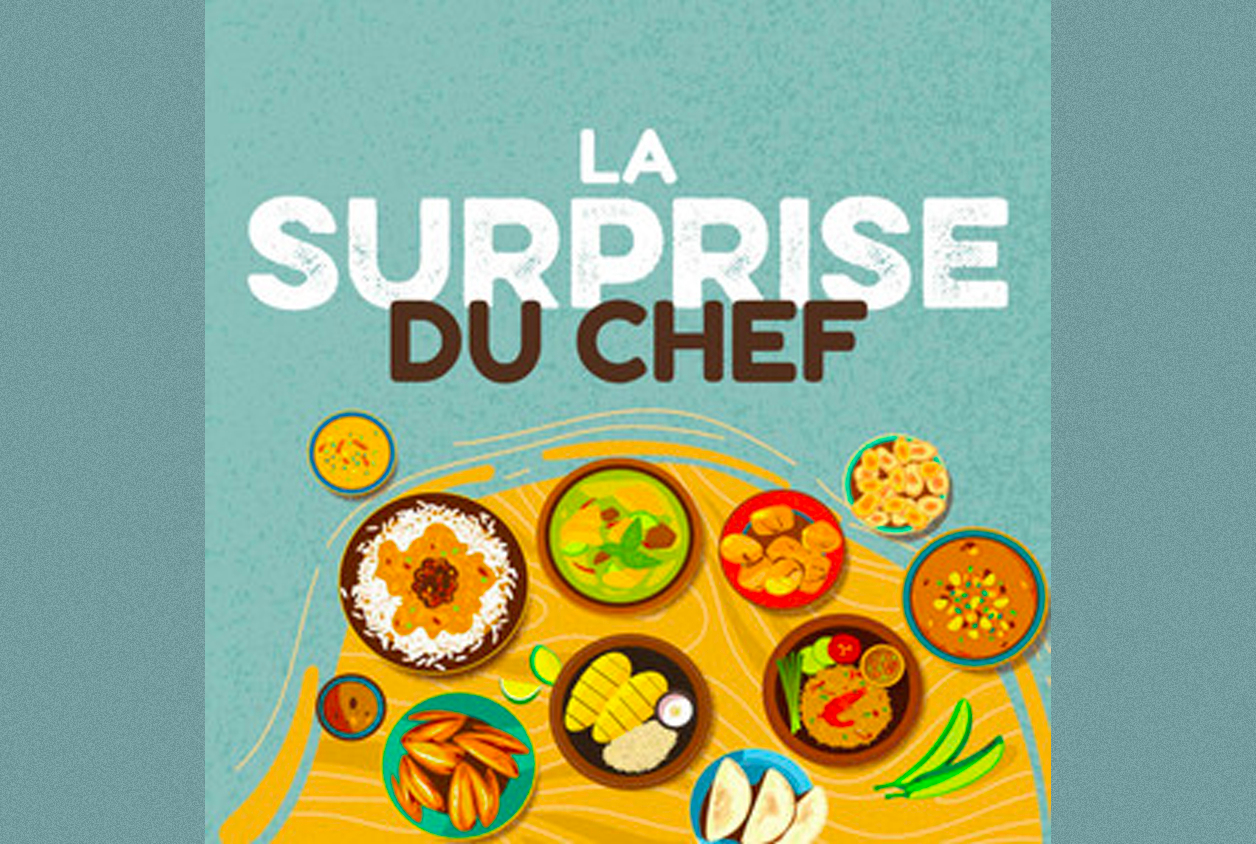L’ACTU VUE PAR – Écrivain aux identités entremêlées, qui se revendique Homo sapiens et Terrien tout en récusant le concept de métissage, Wilfried N’Sondé ressuscite Kimpa Vita dans son nouveau roman, La Reine aux yeux de lune (Robert Laffont). Baptisée Dona Beatriz par les colons portugais qui avaient placé sous leur joug le royaume Kongo, cette jeune héroïne au destin tragique a été à la fois une prophétesse et une figure juvénile de la lutte anticolonialiste au XVIIe siècle.
À la veille de la sortie du livre, l’actualité se révélait tristement mouvementée dans cette Afrique que l’écrivain sillonne régulièrement sans toutefois y résider, où deux coups d’État, au Niger puis au Gabon, sont venus s’ajouter à ceux déjà perpétrés au Mali, en Guinée et au Burkina Faso au cours des trois dernières années.
De cela, et de la place du livre sur le continent, alors qu’à Paris la rentrée littéraire venait de s’ouvrir, Wilfried N’Sondé s’est ouvert à Jeune Afrique.
Jeune Afrique : Quel déclic vous a conduit à relater, en la romançant, l’épopée tragique de Kimpa Vita ?
Wilfried N’Sondé : Je connaissais ce personnage depuis longtemps par l’un de mes frères, Jean de Dieu N’Sondé, historien et spécialiste du royaume Kongo. Le déclic date de 2018, après la publication de mon roman Un océan, deux mers, trois continents [Actes Sud], dans lequel je m’emparais déjà d’un personnage masculin issu de ce royaume, Nsaku Ne Vunda, désigné ambassadeur auprès du Pape Paul V.
À la même période, à Goma, en RDC, j’ai accompagné de jeunes auteurs de courts-métrages. Et dans les locaux du centre culturel Yole ! Africa trônait un poster de Kimpa Vita. J’ai alors pris conscience que nous étions nombreux à la considérer comme une référence ; et c’est là que j’ai décidé d’en faire le personnage principal d’un prochain roman.
Comment résumeriez-vous ce qu’a incarné Kimpa Vita, exécutée à l’âge de 22 ans ?
Elle alliait pensée politique et démarche religieuse. C’était une prophétesse, mais aussi une résistante qui s’opposait à la fois aux agissements des colonisateurs portugais et à ceux des roitelets locaux. Ce qu’avait compris cette jeune femme, qui périt sur le bûcher au début du XVIIIe siècle, me semble toujours d’actualité. Les populations du royaume Kongo souffraient, bien sûr, de la prédation que les Portugais leur infligeaient, mais aussi de l’attitude de leurs propres dirigeants.
Que reste-t-il de Kimpa Vita dans les pays – Angola, Gabon et les deux Congos – qui composaient à l’époque un fragment de ce royaume ?
Chaque 6 juillet, à Mbanza Kongo, l’ancienne capitale royale – qui se trouve aujourd’hui sur le territoire de l’Angola –, on commémore le jour de sa mort. Kimpa Vita est également célébrée jusqu’à Goma, dans le Nord-Kivu, en tant que résistante. On honore même sa mémoire à Dakar, où un festival culturel féministe porte son nom. Un ami, ancien directeur de l’Institut français de Kinshasa, m’a un jour confié que lorsqu’il était en fonction, pas une semaine ne passait sans que quelqu’un ne lui parle de Kimpa Vita. Sur le continent, elle reste présente dans la mémoire collective.
Quelles archives avez-vous consultées pour documenter les événements, anciens, que vous relatez dans La Reine aux yeux de lune ?
Mon frère historien m’a fourni des archives de l’époque, sachant que l’histoire du royaume Kongo a été documentée par des ecclésiastiques portugais ou italiens. Il en va de même pour le rite initiatique qu’est « l’épreuve de la difficulté ». Celui-ci était secret mais un anthropologue néerlandais avait eu l’opportunité d’y assister et l’avait relaté. Ces archives ont alimenté une appropriation romanesque.
Depuis le mois d’août 2020, une vague de coups d’État militaires a secoué successivement le Mali, la Guinée, le Burkina Faso puis, au cours des dernières semaines, le Niger et le Gabon…
Force est de constater que le coup d’État demeure une constante dans la vie politique africaine depuis les soi-disant indépendances. La vie politique sur le continent est depuis longtemps polluée par la violence. Quelles en sont les causes, les sources ? Faut-il y voir le reflet de comportements violents, intolérants, au sein même de nos sociétés ?
Les coups d’État commis au cours des trois dernières années semblent pourtant bénéficier d’un appui enthousiaste d’une large frange de la population. Que vous inspire cette apparente régression ?
Je précise d’emblée que je ne réside pas en Afrique, même si je m’y rends souvent. Je préfère donc m’en tenir à des réflexions générales. Ce que j’observe sur le continent, partout où je me déplace ou presque, c’est la faillite des pouvoirs publics : les défaillances du système de santé comme du système scolaire, la prédation pratiquée à grande échelle par des agents de l’État… Dans un tel contexte, tout changement est perçu comme le bienvenu. Or l’armée véhicule l’image de l’ordre face au désordre indescriptible qui règne dans certains pays, avec une généralisation de la corruption, y compris pour se procurer un banal document administratif.
L’influence grandissante de Wagner m’inspire une immense tristesse. C’est à croire que les populations concernées ont désappris à avoir confiance en elles
Quand on atteint un certain niveau de désespoir et qu’on se dit que cela peut difficilement être pire, pourquoi ne pas s’en remettre à l’armée face à des régimes présentés comme démocratiques mais qui ne se sont pas montrés suffisamment soucieux du bien-être des populations ? Il ne me semble pas que cela soit une bonne solution car c’est une solution guidée par la désillusion.
Aux côtés de certains régimes putschistes, on a vu s’amplifier l’influence du groupe russe Wagner. Célébrer la « Russafrique », vue comme libératrice, tout en vouant la « Françafrique » aux gémonies, n’est-ce pas, au fond, perpétuer l’allégeance à un nouveau maître, lui aussi venu d’ailleurs et bardé d’arrière-pensées ?
Cela m’inspire une immense tristesse. C’est à croire que ces populations ont désappris à avoir confiance en elles et à considérer qu’elles ont la capacité, seules, en s’appuyant sur les ressources dont elles disposent, d’apporter une solution à leurs propres problèmes.
La jeunesse africaine ne doit pas rester focalisée sur les histoires de pétrole, de minerais et autres richesses issues du sous-sol. L’histoire de l’humanité démontre que la véritable richesse se loge dans la tête. L’enjeu, c’est notre capacité collective à mettre nos cerveaux à contribution pour surmonter les problèmes qui se posent au continent.
Qui, selon vous, incarnerait aujourd’hui l’héritage de Kimpa Vita et des autres personnalités africaines qui, au fil des siècles, se sont inscrites dans ses traces ?
Kimpa Vita n’était pas seulement une résistante. C’est aussi quelqu’un qui a proposé un modèle de société, une utopie. Dans cette lignée, je salue les travaux de Felwine Sarr et d’Achille Mbembé, en particulier leurs Ateliers de la pensée, qui se tiennent à Dakar depuis 2016. C’est une initiative extraordinaire, qui n’est pas figée dans la victimisation mais qui est au contraire porteuse d’une réflexion susceptible de conduire, demain, à des actions.
J’apprécie aussi ce qui se passe au Rwanda, où se met en place un véritable modèle de société avec l’appui d’une population bien décidée à faire en sorte que le plus grand nombre puisse mener une vie meilleure. Cette forme de clarté, due en partie à une organisation rigoureuse, s’avère un rempart face à l’arbitraire. On peut s’y tourner vers un policier sans redouter qu’il vous rackette.
Quelles initiatives permettraient, selon vous, de faciliter la diffusion des livres sur le continent ? Vos romans et ceux des écrivains africains édités en Europe ou en Amérique du Nord y sont-ils accessibles ?
À Goma ou à Kinshasa, par exemple, je sais que mes livres sont étudiés dans certains lycées. Il faut rappeler que de nombreux ouvrages peuvent être achetés depuis le continent, au format numérique, à des prix très abordables. Pour que les livres soient diffusés en Afrique, encore faut-il que des lecteurs, sur place, les achètent ; et donc qu’on en finisse avec le cliché qui présente le livre comme un produit culturel trop onéreux pour les Africains. Personne ne tient ce discours concernant les téléphones portables ou les mèches avec lesquelles les femmes se font tresser !
L’identité d’un être humain est fondamentalement composite. Plutôt que de racines, je préfère parler d’héritages dont nous sommes le réceptacle
Non seulement un livre ne coûte pas si cher, mais il dure. Aujourd’hui, mes enfants, adultes, lisent des livres que j’avais moi-même achetés quand j’étais encore au lycée.
Combien d’Africains ont des proches qui font régulièrement la navette entre le continent et des pays où ils peuvent acheter des livres d’occasion ou au format poche ? Ma propre mère, qui envoie des colis au Congo depuis cinquante ans, n’y a jamais fourré un seul livre. Il faut d’abord mesurer l’intérêt que représente un livre avant de faire l’effort d’aller vers lui.
L’obtention du prix Goncourt par le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, en 2021, a-t-il ouvert, symboliquement, une nouvelle ère pour les écrivains africains ?
Mohamed Mbougar Sarr est à la fois intelligent, travailleur et passionné par la littérature. Et avec son excellent éditeur, Philippe Rey, ils ont montré que le travail est toujours récompensé. Il nous faut sortir de la victimisation, de la revendication, et nous mettre au travail.
Pour le reste, Mohamed arrive après une longue série d’écrivains africains déjà primés, comme Wole Soyinka, Alain Mabanckou, Ahmadou Kourouma…
Entre le Congo-Brazzaville où vous êtes né, l’Allemagne où vous avez longtemps vécu, la France où vous avez fait vos études et résidez aujourd’hui, et les différentes parties du monde que vous parcourez en tant qu’écrivain, comment définiriez-vous le métissage culturel dont vous êtes le fruit ?
Je récuse catégoriquement le concept de métissage, qui signifierait qu’il y a eu, à un moment donné, une rencontre entre deux entités fondamentalement distinctes. Or les identités monolithiques n’existent pas. Le royaume du Kongo, que j’évoque dans mon roman, est un creuset d’identités multiples, elles-mêmes en contact pendant cinq cents ans avec les Portugais puis avec les Français. Comment faire le tri ?
Comme les généticiens l’ont démontré, l’identité d’un être humain est fondamentalement composite. Plutôt que de racines, je préfère parler d’héritages dont nous sommes le réceptacle. Du point de vue de la génétique, nous portons encore les traces d’autres formes d’hominidés.
Ce que j’ai appris, c’est que je suis avant tout un Terrien. L’espace de mon existence, c’est cette planète. En tant qu’Homo sapiens, j’en suis un habitant au même titre que l’arbre, le cafard, le lion ou le poisson. Quant aux questions de nationalité, de culture, de religion ou de couleur de peau, elles ne me paraissent pas essentielles. Que je me trouve à Berlin, à Lyon, à Brazza, à Dakar ou à Mexico-City, je m’y sens chez moi puisque je peux y exister. Le métissage, au fond, on s’en fout. Sur cette planète, nous sommes tous chez nous.